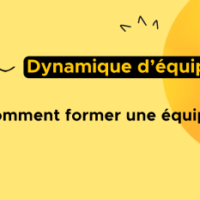Arrêter les slides indigestes : 5 principes scientifiques pour des présentations efficace
- Publié par Emmanuelle
- le
- Thématique : Facilitation graphique
“Mort par PowerPoint” : on en rit, mais c’est un vrai sujet
Vous connaissez sûrement cette scène : une réunion, une conférence, une personne qui lit chaque ligne de son slide, un tableau rempli de chiffres illisibles… Et autour, un public qui lutte entre l’hypnose, la résignation et la consultation discrète de son téléphone sous la table. Ce phénomène a un nom : la mort par PowerPoint.
L’expression n’est pas seulement une blague de consultants. Elle vient d’un manifeste devenu viral en 2007 (Death by PowerPoint), repris par de nombreux médias dont Le Monde, qui parle dans cet article “d’une zombification massive de l’auditoire” devant des slides surchargés.
Conçu pour appuyer le discours visuellement, PowerPoint s’est transformé peu à peu en mur de texte. Résultat : au lieu d’aider la compréhension, nos slides saturent la mémoire et fatiguent l’attention.
Le syndrome de la mort par PowerPoint en chiffres
- 300 millions d’utilisateurs de PowerPoint dans le monde
- 30 millions de présentations réalisées chaque jour
- 84% des organisations perdent du temps et créent de la confusion à cause de slides mal conçus (Canva, 2025)
- … et une infinité de slides remplis de texte que personne ne lit
(Données issues du manifeste original “Death by PowerPoint”, Alexei Kapterev, 2007)
Le problème
- Des slides surchargés en texte qui sature la mémoire et nous font décrocher
- Des données brutes sans mise en forme qui nous font perdre le sens au lieu de le clarifier.
- Des supports pensés comme des documents, pas comme des outils visuels : le public lit… ou écoute, mais rarement les deux.
Faites le test en 30 secondes
Si vous avez coché 2 cases ou plus, vous êtes probablement dans les cas où une communication trop textuelle ralentit la compréhension et la diffusion. Vous faites peut-être partie des 84% des organisations où la mauvaise communication visuelle génère retards et confusion (Canva, 2025) .
Pourquoi votre cerveau adore le visuel
Notre cerveau est une machine à reconnaître, comprendre et mémoriser les images. Ce n’est pas une question de préférence esthétique : c’est un fait biologique.
13 millisecondes pour comprendre une image
Dès qu’une information visuelle arrive, le cerveau se met en action très vite : il la reconnaît, il la comprend, et il la mémorise plus facilement que du texte. C’est un fonctionnement cognitif bien documenté.
Mary Potter, chercheuse au MIT, a démontré en 2014 que le cerveau identifie le sens d’une image en 13 millisecondes. Pour vous donner une idée : c’est 7 fois plus rapide que ce qu’on croyait possible, et plusieurs centaines de fois plus rapide que de lire une phrase.
Concrètement quand vous affichez un schéma clair, votre audience capte instantanément. Quand vous affichez 6 lignes de texte, elle doit choisir entre vous écouter ou lire. Spoiler : elle ne fait ni l’un ni l’autre correctement.
Les images sont encodées 2 fois dans la mémoire
Allan Paivio, (1986) a développé la théorie du double codage :
- Un mot est encodé 1 fois (verbalement)
- Une image est encodée 2 fois (visuellement + verbalement)
Combiner texte + image = 89% d’amélioration de l’apprentissage par rapport au texte seul (Mayer, 2009).
Trop de texte, plus de surcharge cognitive
John Sweller, (1988) a théorisé la charge cognitive : votre mémoire de travail a une capacité limitée (environ 7 éléments à la fois). Quand vous proposez 15 éléments dans une liste à puces, un graphique et une explication orale en même temps, vous saturez le système.
Les visuels bien conçus réduisent cette charge de 35 à 40% en structurant l’information et en permettant au cerveau de traiter les choses par canaux séparés (visuel et auditif).
On peut parler de théorie, de neurosciences ou de modèles de cognition, mais ce qui compte réellement pour vos équipes, c’est le résultat dans le quotidien. Dès qu’on introduit de la visualisation dans sa manière de travailler, partager ou piloter une idée, les effets sont visibles immédiatement :
- plus de clarté
- moins de confusion
- des décisions plus rapides
Le mythe du "Je ne suis pas visuel"
Le modèle VAK (certains seraient Visuels, d’autres Auditifs, d’autres Kinesthésiques) a été démenti scientifiquement (Pashler et al., 2008).
Ce qui est vrai :
- On traite tous les images 60 000 fois plus vite que le texte (c’est biologique)
- On mémorise tous mieux quand on combine plusieurs canaux (texte + image + oral)
- Les “préférences” existent, mais elles ne déterminent pas l’efficacité de l’apprentissage
Ce n’est pas une question de “profil”, plutôt une question de neurologie.
Les usages des nouvelles générations
Les générations qui arrivent aujourd’hui en poste ont grandi avec des contenus visuels : réseaux sociaux, vidéos courtes, interfaces claires…
D’après le rapport “State of Visual Communication 2025″ publié par Canva :
- 90 % des professionnels de la Gen Z déclarent travailler mieux lorsqu’ils peuvent visualiser l’information.
- 87 % estiment que la maîtrise du visuel est devenue une compétence clé dans leur carrière
- 89 % affirment qu’un support de travail visuel augmente leur autonomie et leur engagement.
Pour une grande majorité des professionnels de 20-30 ans, le visuel n’est pas un bonus, mais la norme. Ce n’est pas une lubie générationnelle, c’est l’aboutissement d’une évolution cognitive liée aux interfaces numériques. Vos équipes juniors trouvent probablement vos slides textuels… illisibles et contre-productifs. Et elles n’ont pas tort : 76% des professionnels tous âges confondus décrochent face à des contenus trop textuels.
Comment concevoir des supports plus visuel
Il existe des principes simples et éprouvés scientifiquement pour créer des supports plus clairs. Richard E. Mayer, professeur de psychologie à l’université de Californie, en a identifié plusieurs que l’on peut appliquer au travail à n’importe quel support (slide, paperboard, rapport…).
Les 5 principes qui fonctionnent
Principe 1 - Cohérence : allez à l’essentiel
Évitez tout ce qui n’aide pas à comprendre votre message : décor, phrases inutiles, images gadget. Chaque élément affiché doit avoir une fonction : informer, clarifier, ou faire retenir. Le reste distrait.
- Avant d’ajouter une image ou un encart, demandez-vous : “Ajoute-t-il du sens, ou juste du décor ?”
Principe 2 - Signalisation : montrez où regarder
Le regard a besoin d’être guidé. Mettez en avant, visuellement, ce qui compte. Une flèche, un encadré, un mot en gras, une couleur bien choisie… permettent à l’œil de savoir où aller, et au cerveau de savoir quoi retenir.
- En facilitation graphique, on parle d’”accroche visuelle” : une métaphore ou un symbole qui rend le message immédiatement lisible.
Principe 3 - Contiguïté : regroupez ce qui va ensemble
Placez le texte explicatif près de l’image ou du schéma qu’il commente. Si l’œil doit trop chercher, il décroche.
Si les éléments ne sont pas regroupés, le cerveau doit faire des allers-retours pour relier les deux, ce qui augmente l’effort mental et ralentit la compréhension.
Principe 4 - Segmentation : une idée à la fois
Découpez votre message en petites unités.
- Un slide = une idée
- un schéma = une étape
- un bloc = un concept
Plus vous segmentez, plus la lecture devient fluide… et plus il est possible de suivre. Multiplier les slides n’est pas un problème mais un slide trop dense, oui.
Principe 5 - Modalité : ne faites pas tout lire et tout écouter en même temps
Si vous parlez, n’affichez pas tout votre texte à l’écran. Affichez des éléments visuels qui soutiennent votre discours, pas des blocs de texte qu’on essaye de lire en même temps que vous parlez.
- Un bon support visuel n’est pas un téléprompteur.
À noter : Et la facilitation graphique là-dedans ?
Elle applique ces principes naturellement : segmentation de l’espace, structuration visuelle, usages de pictos, hiérarchie des éléments, accroches visuelles.
Par où commencer concrètement ?
Quelques pistes simples pour transformer vos slides sans tout refaire :
1. Supprimez les longs blocs de texte
La prochaine fois que vous vous apprêtez à écrire un paragraphe dans un slide… demandez-vous si un diagramme, une frise, un tableau à 2 colonnes ou une carte mentale ne ferait pas le même travail, mais plus vite.
- Exemple : un processus de décision peut devenir une simple flèche en 4 étapes, plutôt qu’une liste de phrases.
2. Titrez vos slides par le message, pas par le thème
Au lieu de “Résultats du trimestre” écrire “Les ventes progressent de 12 %, mais seulement sur 2 lignes de marché”. C’est un changement simple, mais il oriente immédiatement l’attention de l’auditoire.
- Gardez en tête l’approche un slide = une phrase clé que vous pourriez dire à l’oral.
3. Restez minimaliste
Trois à quatre éléments maximum par slide suffisent.
- Au-delà, le cerveau scanne, hésite, ou décroche. Mieux vaut faire 3 slides avec 3 éléments que 1 slide avec 9.
4. Ajoutez une touche humaine
Une fois que le support simplifié, pensez à ce qui aide le groupe à se connecter au sujet : un picto, une anecdote, une citation, une couleur ou schéma dessiné etc.
- Un élément illustré peut créer une connexion émotionnelle ou relationnelle. Ce sont ces détails qui créent le lien.
Le visuel n’est pas un “plus”
Si vous aviez encore un doute : le visuel n’est pas une question de style, ni de “faire joli”. C’est une manière de travailler qui colle mieux à la façon dont le cerveau traite l’information, apprend, décide… et coopère avec les autres. Ce n’est pas une question de talent en dessin, ni une discipline réservée aux “créatifs”. C’est une compétence de communication professionnelle.
Ce qu’il faut retenir, c’est que produire un support visuel ne demande pas d’être bon en dessin, mais de savoir structurer et rendre visible ce qui compte. La bonne question à se poser c’est : “Comment est-ce que je peux rendre cette idée visible ? Comment faire pour qu’on se comprenne en un coup d’œil ?“
Vous souhaitez vous former ?
Vous avez compris le “pourquoi” mais pour passer vraiment au visuel au quotidien, vous avez besoin de méthodes ? Nous animons des formations en présentiel (ou en ligne) adaptées à votre contexte.
Contactez-nous pour toute demande sur mesure !
Sources
Voici la liste des ressources utiles sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour rédiger cet article.
Études scientifiques et théories de référence
- Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning. Cambridge University Press.
Les 12 principes d’ergonomie multimédia validés expérimentalement - Paivio, A. (1986). Mental Representations: A Dual Coding Approach. Oxford University Press.
La théorie du double codage : pourquoi les images sont encodées 2 fois dans la mémoire - Potter, M. (2014). “Detecting meaning in RSVP at 13 ms per picture”. Attention, Perception, and Psychophysics, MIT.
Le cerveau identifie une image en 13 millisecondes - Sweller, J. (1988). “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning”. Cognitive Science, 12(2), 257-285.
La théorie de la charge cognitive et l’impact des visuels bien conçus - Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). “Learning Styles: Concepts and Evidence”. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105-119.
- Démystification du modèle VAK (Visuel/Auditif/Kinesthésique)
Articles et rapports
- Kapterev, A. (2007). Death by PowerPoint (and how to fight it). Manifeste diffusé sur SlideShare.
- Santolaria, N. (2018). “PowerPoint m’a tuer”. Le Monde, 16 janvier 2018.
Le phénomène de “zombification massive” de l’auditoire - Canva (2025). The State of Visual Communication 2025.
Étude sur 2400+ professionnels dans 8 pays sur l’impact du visuel au travail - Duarte, N. (2017). Slide:ology, The Art and Science of Creating Great Presentations. Diateino.
Un document de plus de 75 mots devrait être imprimé, pas projeté
Ressources complémentaires
- MIT News (2014). “In the blink of an eye”. Article sur les travaux de Mary Potter.
- Vidéo : “Les principes d’ergonomie multimédia” – Synthèse des 12 principes de Richard E. Mayer
- Vidéo : “Les neuromythes en Pédagogie” – Sur la déconstruction des idées reçues sur l’apprentissage
L'autrice
Découvrez nos formations :
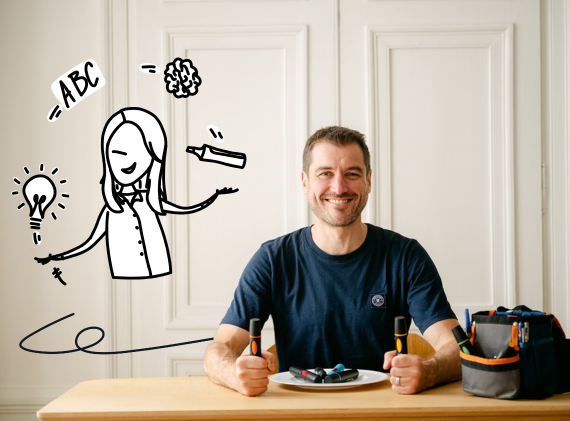
Facilitation graphique
5 modules pour découvrir la pensée visuelle : des exercices, des échanges en live et une communauté soudée !

Sketchnoter sur tablette
Vous pratiquez la pensée visuelle sur papier et vous envisagez de passer au numérique ? Cette formation vous guide pas à pas.

IA4Product
Un bootcamp pour les responsables produit qui veulent améliorer leur quotidien avec l’IA.