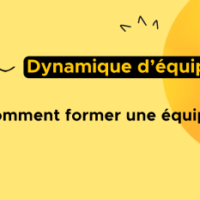Dessiner l’invisible : retour d’expérience sur une prestation de scribing dédiée au sexisme ordinaire
- Publié par Romain
- le
- Thématique : Facilitation graphique
J’ai été sollicité pour restituer en direct, en facilitation graphique, deux tables rondes sur le thème du sexisme ordinaire, lors d’un événement interne organisé par un grand groupe du secteur de la construction. Mon rôle était d’écouter, comprendre, et représenter visuellement ce qui allait être dit, devant une centaine de personnes, puis restituer la fresque à l’oral, quelques heures plus tard.
Je savais que cette mission serait exigeante, tant par la nature du sujet que par les conditions dans lesquelles elle allait se dérouler. Mais je ne mesurais pas encore à quel point le dessin pouvait, ici, devenir un outil concret pour rendre visible ce qui, d’ordinaire, ne se voit pas.
Note : pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous partager le livrable de la mission mais simplement quelques extraits en noir et blanc.

Prestation de scribing sur le sexisme ordinaire
Un sujet diffus, complexe, mais bien réel
Le sexisme ordinaire, c’est celui qui ne se présente presque jamais comme une agression frontale. Il s’installe dans les remarques “bienveillantes”, les suppositions, les décisions implicites, les opportunités offertes à certains et non à d’autres “pour leur bien”. C’est un phénomène particulièrement difficile à identifier, à nommer, et a fortiori à représenter. Je suis intervenu dans un contexte où ce sujet était pris au sérieux, avec la volonté de l’aborder de manière collective et concrète.
L’événement réunissait à la fois les membres d’un réseau interne de femmes et, pour la première fois, plusieurs managers hommes, invités à écouter, comprendre et agir. Mon rôle était de mettre en image ce qui allait se dire, sans déformer, sans surjouer, sans minimiser. Je savais donc que le dessin ne suffirait pas à lui seul : ce serait avant tout une affaire d’écoute attentive, de justesse, et de posture.
Une préparation… inattendue

Prestation de scribing sur le sexisme ordinaire
La veille de l’événement, je n’avais quasiment aucun contenu précis. Le programme était défini, mais pas les messages clés ni les témoignages. J’ai reçu, au dernier moment, une invitation à partager le dîner avec les intervenantes de la table ronde.
Par un hasard complet, je me suis retrouvé devant le bon restaurant sans qu’on m’ait donné l’adresse. Ce dîner improvisé a changé ma préparation : il m’a offert une première écoute, dans un contexte informel mais précieux. J’ai pu entendre des récits, des nuances, des émotions. J’ai découvert aussi à quel point certaines scènes décrites comme “ordinaires” étaient en réalité profondément structurantes pour celles qui les vivaient. Ce temps d’échange, en amont, m’a permis d’aborder l’événement avec une compréhension plus fine, bien qu’encore partielle, de ce qui allait se jouer sur scène.
La recherche visuelle : un exercice d'équilibriste

Prestation de scribing sur le sexisme ordinaire
Une fois rentré à l’hôtel, j’ai poursuivi mes recherches visuelles. Comment représenter quelque chose qui, par nature, est invisible ? Le sexisme ordinaire n’est pas spectaculaire. Il ne se voit pas. Il se devine, se ressent, se subit. J’ai exploré plusieurs pistes visuelles. Des métaphores : une femme retenue par un élastique pour évoquer le plafond de verre. Des scènes de chantier et de bureaux pour ancrer dans le réel du secteur. Des situations du quotidien : la machine à café, la réunion, l’entretien annuel.
Mon style de dessin repose beaucoup sur les coupes de cheveux pour différencier les personnages. Une approche épurée, mais qui devait servir le message sans le parasiter. L’enjeu n’était pas de faire de “beaux” dessins, mais des dessins justes.
Le jour J : tout se joue en direct

Prestation de scribing sur le sexisme ordinaire
Le matin de l’événement, la première prise de parole prévue n’a pas été celle que j’attendais. Au lieu de débuter directement par la table ronde, une animatrice a pris le micro pour introduire le contexte, partager des chiffres et des constats. Je n’avais rien de cela dans mon brief, mais je devais décider très vite : est-ce que je dessine, ou est-ce que je laisse passer ? C’est une décision que je dois prendre régulièrement : si je ne trace rien, la mémoire de ce moment disparaît. Si je trace trop tôt, je prends le risque de saturer la planche, au détriment du reste.
J’ai choisi de dessiner, quitte à ajuster ensuite. Et c’est souvent là que se trouve l’enjeu du scribing : accepter d’avancer en marchant, sans plan entièrement verrouillé.
La première table ronde a ensuite commencé avec trois collaboratrices venues témoigner de leurs expériences accompagnées de l’animatrice. Elles ont abordé la maternité, les blagues sexistes, l’évolution professionnelle, la légitimité.
Je dessinais presque en continu, tout en surveillant l’espace disponible, le rythme des prises de parole, et les connexions possibles entre les idées. Mais il y avait une complexité supplémentaire : distinguer la scène racontée du message à retenir. Certaines intervenantes donnaient des exemples concrets suivis de leur analyse. D’autres partageaient simplement un message direct : “Il faut être forte.” Mais sans histoire pour le soutenir.
Quand le scribing rencontre l’inattendu

Prestation de scribing sur le sexisme ordinaire
Au cours d’une prise de parole, une intervenante raconte une scène vécue sur un chantier. Elle demande à son collègue masculin s’il est bien équipé. Il lui répond : “C’est bon, j’ai ma b*** et mon couteau.”
Ce à quoi elle répond “Les couteaux sont interdits sur les chantiers et toi, tu ferais mieux de garder ta b**** dans ton pantalon, vu les outils qu’on utilise : les disqueuses, les marteaux….“ Rire dans la salle. Malaise.
Que fait-on de ce type de phrase, quand on dessine en direct ? Est-ce qu’on la retranscrit telle quelle ? Est-ce qu’on s’autorise à la filtrer ? Est-ce qu’on la symbolise ? Ici, j’ai fait le choix de la représenter : deux personnages sur un chantier, un homme qui rougit face à une femme que j’ai dessinée plus grande pour montrer qu’elle reprend le pouvoir. Dans les bulles : “Les couteaux sont interdits” et “Garde ta bite dans ton pantalon.” Pas de filtre, mais une mise à distance par l’image.
Ce moment m’a rappelé que le dessin est parfois un tiers facilitateur : il permet de mettre à distance des propos forts, sans les effacer, et en les rendant discutables collectivement. L’humour dans cette scène n’était pas gratuit : il était un outil de réappropriation du pouvoir.
La restitution : un moment d’ancrage

À cinq minutes de la fin, il ne me restait que le texte, aucun fond coloré. Or, sans couleur ni contraste, une fresque reste difficile à lire. Comme je travaille en monochrome, il faut que je pose des couleurs en arrière-plan des textes pour que la planche respire. J’ai fait la mise en blanc et en couleur en trois minutes, juste avant de monter sur scène.
Une fois la fresque terminée, je la présente à l’audience. J’observe des réactions : le dessin déclenche parfois de la surprise, parfois de la reconnaissance, parfois du malaise. Mais dans tous les cas, il donne du relief aux mots. Il améliore la compréhension. Il fait revenir des éléments qui, autrement, se seraient dissipés.
J’ai choisi de terminer ma restitution sur l’anecdote du couteau. C’était un choix délibéré : finir sur une pointe d’humour pour amener de la légèreté, tout en restituant fidèlement ce qui avait été dit. Et aussi parce que cette scène incarnait parfaitement le message de la journée : reprendre le pouvoir face au sexisme ordinaire.
Plusieurs personnes m’ont dit, en sortant, qu’elles ne s’attendaient pas à ce que la restitution soit faite en direct, “au fur et à mesure”. C’est un retour que j’entends régulièrement : la fresque donne l’impression d’avoir été préparée, tant elle est fluide. C’est l’un des effets positifs du scribing : il permet de valoriser les contenus d’un événement sans jamais voler la parole à celles et ceux qui l’ont portée.
Ce que je retiens de cette expérience

Trois choses, principalement :
1. Le dessin rend visible ce qui ne l’est pas. Pour un sujet comme le sexisme ordinaire, c’est essentiel : l’illustration permet de matérialiser des dynamiques qui, souvent, ne sont jamais formalisées.
2. La posture compte autant que le trait. En tant qu’homme, je n’étais pas neutre dans cette intervention. J’ai dû trouver ma place : écouter, comprendre, restituer, sans surinterpréter. C’est aussi une responsabilité.
3. Le scribing est une façon de prolonger le débat. La fresque peut servir après l’événement : elle peut ouvrir des discussions entre managers, servir de support pour des prises de conscience.
Quand il est mis au service d’un sujet comme le sexisme ordinaire, le scribing devient un outil de prise de conscience. Il permet de garder une trace et poser des mots (et des images) sur des situations qui restent souvent diffuses, implicites, ou minimisées.
Dessiner en direct m’a permis de capter non seulement les contenus, mais aussi les non-dits, les émotions, les nuances. Et c’est cette dimension-là, je crois, qui a marqué les participant·es : le fait de pouvoir se reconnaître dans une scène, la voir posée là, noir sur blanc, et se dire : “Oui, c’est bien ce que je vis ou ce que j’observe.“ Je retiens que la facilitation graphique peut être un réel soutien dans les démarches de transformation culturelle, surtout lorsqu’il s’agit de sujets sociaux sensibles. Elle ne résout rien à elle seule évidemment mais elle contribue à ouvrir une porte. Et parfois, c’est tout ce qu’il faut pour commencer à bouger.
Au-delà de la technique, cette prestation m’a aussi apporté une satisfaction personnelle. Je ne sais pas si je suis un allié, mais ces sujets me parlent. Ce sont des choses que je comprends et que je ne tolère pas. J’étais content d’être là, de contribuer à ce moment. Et d’avoir repoussé mes limites professionnelles en traitant un sujet que je n’avais jamais abordé jusqu’à présent.

Une synthèse visuelle pour votre événement ?
Si vous avez un séminaire, une journée d’équipe ou une conférence à venir, nous pouvons vous aider à en capturer visuellement les messages clés de manière claire, vivante et partageable.
Échangeons à ce sujet !
L'auteur
Romain Couturier
J’aide les équipes à mieux organiser leur travail pour gagner en fluidité et en efficacité au quotidien. Ce que j’aime le plus, c’est explorer les dynamiques de groupe et transmettre des outils qui rendent le travail plus clair et collaboratif. Si vous voulez en discuter ou découvrir mes partages, connectez-vous avec moi sur LinkedIn !
Découvrez nos formations :
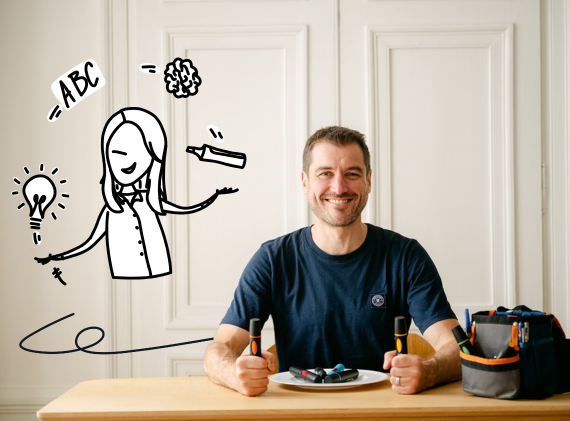
Facilitation graphique
5 modules pour découvrir la pensée visuelle : des exercices, des échanges en live et une communauté soudée !

Sketchnoter sur tablette
Vous pratiquez la pensée visuelle sur papier et vous envisagez de passer au numérique ? Cette formation vous guide pas à pas.

IA4Product
Un bootcamp pour les responsables produit qui veulent améliorer leur quotidien avec l’IA.