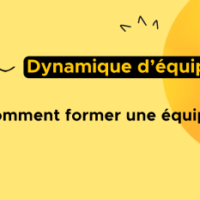Les 5 dysfonctionnements d’une équipe : un classique du management toujours d’actualité
- Publié par Emmanuelle
- le
- Thématique : Organisation du travail
Cet article s’inspire en partie de notre formation gratuite “Les Fondamentaux de l’Agilité“. Pour aller plus loin et découvrir comment intégrer concrètement l’Agilité dans votre organisation, retrouvez ici la formation gratuite complète.
Certaines équipes semblent marcher au ralenti. Les réunions tournent en rond, les décisions s’effilochent… les mêmes problèmes reviennent, les tensions s’accumulent, chacun semble jouer sa propre partition. Alors, pourquoi ça coince ?
Patrick Lencioni, auteur de l’ouvrage The Five Dysfunctions of a Team, nous aide à comprendre ce qui se joue sous la surface et surtout comment y remédier. Son approche systémique montre que la performance collective repose sur une succession d’ingrédients qui s’empilent, un peu comme les étages d’une pyramide. Manquez la base, et tout l’édifice devient instable.
Lencioni propose une pyramide inversée. Tout part du bas : si vous n’avez pas de confiance dans l’équipe, vous évitez les vrais débats. Si vous évitez les débats, personne ne s’engage vraiment sur les décisions. Sans engagement, personne ne se sent responsable. Et au final, chacun défend son pré carré plutôt que l’objectif commun. C’est logique quand on le pose comme ça. Mais sur le terrain, ces mécaniques sont souvent invisibles. On voit juste qu’il y a un problème, sans comprendre d’où ça part.
1. L'absence de confiance
La confiance ce n’est pas “bien s’entendre”. C’est pouvoir dire “je ne sais pas”, “j’ai besoin d’aide”, ou “je me suis trompé” sans craindre de perdre la face. Une équipe sans confiance, c’est une équipe sur la défensive. On évite de parler de ses erreurs, on se protège, on communique par silos. Résultat : moins de créativité, plus de stress, et beaucoup d’énergie perdue.
Ce qu’on peut faire
- Instaurer des temps d’échanges où l’on partage aussi bien les réussites que les échecs.
- Ritualiser ces points d’avancement, valoriser la transparence plutôt que la perfection
- et rappeler que demander un retour n’est pas un signe de faiblesse, c’est un signe de professionnalisme.
2. La peur du conflit
Les réunions sont polies, ennuyeuses, improductives. On évite soigneusement les sujets sensibles. En apparence, tout le monde est d’accord et l’équipe conserve une harmonie de façade. Quand une personne ne comprend pas la direction d’un projet mais n’ose pas le dire, le groupe avance à deux vitesses : l’un croit avoir expliqué, l’autre croit devoir deviner. Les décisions sont médiocres, l’innovation limitée, les problèmes persistent, et la frustration monte en silence. Jusqu’au jour où elle explose, souvent de manière disproportionnée.
Ce qu’on peut faire
- Transformer le conflit perçu comme “dangereux” en conflit utile
- Former les membres aux techniques de débat constructif
- Encourager la confrontation d’idées plutôt que la confrontation de personnes
- Dans une équipe en apprentissage, il peut suffire d’un “explique-moi comment tu vois les choses” pour éviter des heures de malentendus
3. Le manque d'engagement
Les décisions sont floues ou ambiguës et on revient constamment sur ce qui a été décidé. L’équipe manque d’alignement, les opportunités passent, et personne ne sait vraiment ce qui a été convenu. “Je pensais que tu t’en occupais !” devient le refrain quotidien. Sans décisions claires, une équipe manque d’engagement et est souvent… dans le flou.
Ce qu’on peut faire
- Adopter un rituel simple : en fin de réunion, résumer ce qui a été décidé, qui fait quoi, et pour quand
- Définissir des échéances claires et partagez-les visuellement (un bon vieux tableau Kanban fonctionne toujours). Y revenir régulièrement pour ajuster
4. L'évitement des responsabilités
L’absence de responsabilité partagée crée un terrain favorable à la médiocrité. Chacun.e se concentre sur son périmètre cultivant une culture du “ce n’est pas mon problème” et laisse le reste “à la hiérarchie”.
Ce qu’on peut faire
- Mettre en place des revues régulières où chaque membre présente ses avancées et reçoit le feedback de ses pairs
- Et surtout, relier la responsabilité à l’autonomie : “tu as carte blanche pour tester, mais partage les résultats”. C’est souvent dans ces moments qu’un profil junior ou même un manager réalise que rendre compte n’est pas se justifier, c’est contribuer
- Responsabiliser chaque membre sur les résultats collectifs, pas seulement individuels.
5. L'inattention aux résultats
Quand les objectifs individuels prennent le dessus, l’équipe perd de vue les objectifs communs. Les comportements territoriaux s’installent, la coopération s’effrite. On se concentre sur sa partie, ses urgences, ses micro-objectifs et on oublie que le succès est collectif.
Ce qu’on peut faire
- Définir des objectifs collectifs clairs et suivre les progrès ensemble via un tableau de bord partagé. Ramener régulièrement les discussions à la valeur produite pour les utilisateurs, les clients.
- Lier les récompenses aux résultats collectifs, pas seulement individuels
- Créer des moments de célébration d’équipe quand un jalon important est atteint.
- Renforcer la vision commune régulièrement. On l’oublie trop souvent.
Transformer une équipe dysfonctionnelle, c’est un travail de fond. Et avant tout, ça commence par un diagnostic honnête : où en est notre équipe sur ces cinq niveaux ?
Beaucoup de modèles mettent l’accent sur les dynamiques collectives. Mais sur le terrain certaines équipes sont plombées par des comportements individuels. Elles ne font pas face à des tensions passagères ou une phase d’apprentissage : elles sont réellement abîmées par un manque de sécurité psychologique, un déséquilibre de pouvoir ou la présence de personnalités toxiques qui verrouillent la communication.
Dans ces cas-là, on ne parle plus de cohésion mais on gère un risque humain. Il y a des équipes qu’on peut aider à retrouver un fonctionnement sain d’autres non. Et parfois l’accompagnement mène jusqu’à la séparation. La confiance est partie en miettes, le pouvoir s’est déséquilibré, ou quelques personnalités ont pris toute la place, et aucun rituel collectif ne répare une relation abîmée par la peur ou la défiance.
Et c’est là que le rôle du manager n’est plus de “recoller les morceaux” mais d’évaluer s’il reste quelque chose à sauver (et à quel prix). Reconnaître qu’une équipe ne fonctionne plus, c’est un acte de lucidité. C’est ce qui permet de dire : “on a essayé, on a appris, on fera autrement.”
Pour aller plus loin
Cet article s’inspire en partie de notre formation gratuite “Les fondamentaux de l’Agilité“. Notre idée est de proposer un parcours complet (près de 20h répartis en 9 modules), pour celles et ceux qui veulent renforcer l’organisation du travail de leur équipe et en améliorer le fonctionnement grâce à une approche agile.
L'autrice
Découvrez nos formations :
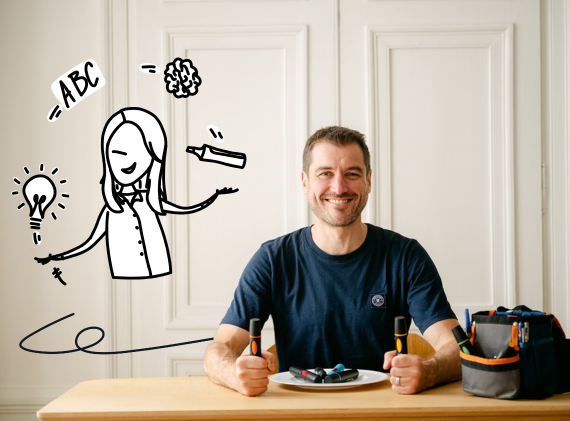
Facilitation graphique
5 modules pour découvrir la pensée visuelle : des exercices, des échanges en live et une communauté soudée !

Sketchnoter sur tablette
Vous pratiquez la pensée visuelle sur papier et vous envisagez de passer au numérique ? Cette formation vous guide pas à pas.

IA4Product
Un bootcamp pour les responsables produit qui veulent améliorer leur quotidien avec l’IA.